PREPARE TOI A LA RENCONTRE DE TON DIEU
Site menu
Sections
Our poll
Blog
Main » 2008 August 02 » Les Perses|
Les Perses |
1:29 PM |
 L'empire Perse sous les Archéménides Carte Hachette Multimédia Le territoire de la Perse antique correspond approximativement à celui de l'actuelle République islamique d'Iran, et l'antique Perside à l'actuelle province de Fars (région de Chiraz). Cet immense empire attisa sans cesse la convoitise des royaumes voisins. Alexandre le Grand,
reprenant le rêve mythique de Philippe de Macédoine, la
conquit et tenta de réaliser l'union de l'Orient et de
l'hellénisme, mais son oeuvre ne lui survécut pas. La Perse est un ensemble de hauts plateaux, d'une altitude généralement supérieure à 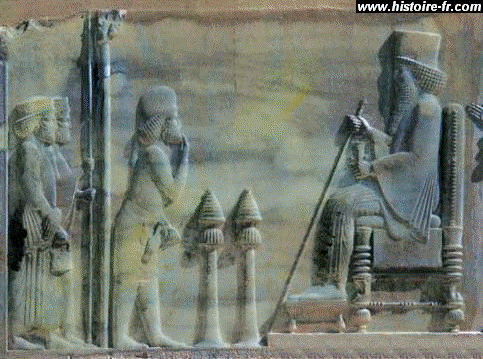
Devant
l'absence de sources écrites, c'est l'archéologie qui met
en valeur l'originalité de plusieurs cultures régionales,
notamment celle d'Amlach, avant qu'apparaissent, dans les annales
assyriennes, les nouveaux venus des steppes d'Asie centrale : les Mèdes, au sud de la Caspienne, les Perses plus au sud et les Parthes plus à l'est. Les
Aryens sont de redoutables cavaliers, qui s'établissent sur un
plateau encore peu peuplé, où ils vont fonder des
principautés indépendantes. L'Elam ne leur résiste
pas, et cependant l'Empire assyrien multiplie les expéditions
contre eux, lesquelles sont d'ailleurs toujours
présentées comme victorieuses. Au VIIe
siècle, les Mèdes prennent l'avantage ; leur roi
Cyaxare (vers 633-584), allié des Babyloniens, participe
à l'effondrement de l'Empire assyrien (612, chute de Ninive),
annexe l'Assyrie et récupère ainsi ses possessions d'Asie
Mineure - ce qui lui permet d'étendre son empire à
l'ouest, jusqu'à l'Halys. Le souverain contrôle tous ses
territoires depuis la capitale, Ecbatane (aujourd'hui Hamadhan). 
Les Achéménides vont dominer tout le territoire iranien. Cyrus II
pousse les limites de son Empire jusqu'à l'Asie centrale, mais
fonde sa capitale, Pasargades, en Iran (550). Il vainc Crésus,
roi de Lydie (546), soumet certaines villes grecques d'Asie Mineure, et
étend son emprise jusqu'à l'Iaxarte (l'actuel Syr-Daria).
Il conquiert Babylone (539), la Mésopotamie, la Syrie, la Phénicie et la Palestine.

La
rapidité de cette expansion s'explique par les qualités
militaires des soldats, mais aussi par une grande tolérance
envers les peuples soumis. Les conquêtes se sont rarement
accompagnées d'exactions ou de pillages, actes habituels du
temps des Assyriens. Cyrus, accueilli le plus souvent en
libérateur, est sans conteste le plus magnanime des
conquérants perses. À Babylone, ainsi que dans tout Sumer
et Akkad, il honore les dieux locaux et protège les lieux de
culte ; c'est le cas à Our, où il fait
réparer l'enceinte du temple de Sin, les temples de Nanna-Sin et
de Nongal, ainsi qu'à Ourouk, où il entreprend la
restauration de l'Eanna. Sa sollicitude va aussi aux juifs ; il
fait reconstruire leur temple à Jérusalem et rapatrie,
sur les bords de l'Euphrate, les anciennes populations
déportées par Nabuchodonosor. Mais Cyrus meurt en opération contre les Massagètes, nomades vivants à l'est de Cependant,
Cyrus et Cambyse, tout occupés à la conquête, ont
négligé l'organisation administrative de l'Empire.

Darius I
(522-486), qui leur succède après avoir fait assassiner
son prédécesseur, Gaumata - accusé
d'être un mage qui s'est fait passer pour Bardiya, fils de Cyrus
II - , comblera cette lacune. Le nouvel empereur réorganise
l'Empire en vingt satrapies payant tribut ; l'élaboration
d'un Code de lois souple lui permet d'établir un contrôle
unifié sur tout le territoire. Il frappe la première
monnaie stable perse (en or), la darique, et uniformise les poids et
mesures. Darius I entreprend également une série de grands travaux, dont le creusement d'un canal reliant le Nil à
 A
l'instar des empires orientaux qui l'ont précédé,
l'Empire perse est une «monarchie absolue» à base
religieuse ; toutefois, bien qu'il se réclame du dieu
suprême des Perses, Ahura-Mazda, Darius Ier ne néglige pas
les divinités des peuples assujettis ; les cultes
d'Amon-Rê, en Egypte, et de Mardouk, en Babylonie, sont officiellement reconnus. Le
même souci de tolérance transparaît à travers
l'organisation administrative. Le système des satrapies
organisé par Darios Ier est calqué sur le modèle
des provinces assyriennes ; bien que gouvernées par des
satrapes relevant de l'autorité impériale, elles
jouissent d'une indépendance de fait ; les agents de
l'administration centrale se contentent de percevoir le tribut et
d'exercer la justice supérieure dans le respect des traditions
locales. Cependant,
les entreprises militaires de Darius I sont moins heureuses que ses
réformes administratives. Il est repoussé par les Scythes en 513 av. J.-C.,
et l'Ionie se révolte à partir de 499, ce qui va
déclencher les guerres médiques. Sa tentative pour punir Athènes le conduit à la rude défaite de Marathon, en 490. Une invasion massive de la Grèce
par son fils Xerxès, qui tente de soumettre l'ensemble du monde
hellénique, est pareillement contenue lors de la bataille navale
de Salamine, en 480, et, l'année suivante, à
Platées et à Mycale. Après la mort de Darius I, les difficultés intérieures de l'Empire ne cessent de croître - révolte de l'Égypte (486-485), puis de Babylone (482 ou 479), intrigues, corruption, etc. Reflet de l'Empire, l'armée manque de cohésion et son commandement se révèle de plus en plus difficile. source : www.memo.fr | |
| Category: DOSSIER HISTORIQUE | Views: 955 | Added by: sourcedevie | Rating: 0.0/0 | | |
| Total comments: 0 | |